Abandon de poste : ce que dit la loi et comment appliquer la procédure
Depuis la loi Marché du travail, une présomption de démission a été introduite en cas d’abandon de poste. Une nouvelle réglementation confirmée à plusieurs reprises par la jurisprudence, malgré la bataille menée par les syndicats de salariés. Pour autant, l’employeur doit tout de même respecter une procédure stricte. Explications détaillées.

C’est un mécanisme encore souvent méconnu des employeurs. Et pourtant, depuis la loi Marché du travail du 21 décembre 2022, les salariés qui abandonnent leur poste peuvent désormais être considérées comme démissionnaire. Pour les entreprises, cette évolution législative constitue une véritable révolution, dans le sens où désormais elles n’ont plus à entreprendre de démarches de licenciement en cas d’abandon de poste, avec tous les risques financiers et juridiques qui y sont associés. Malgré tout, une procédure assez stricte doit tout de même être respectée. Mais cela reste moins contraignant qu’un licenciement. Explications détaillées.
Qu’est-ce qu’un abandon de poste ?
Même s’il n’en existe pas de définition à stricto sensu dans le Code du travail, l’abandon de poste se caractérise aujourd’hui par l’absence injustifiée ou répétée d’un salarié pendant ses heures de travail. Il n’existe pas de délai légal pour caractériser un abandon de poste. Une absence peut être considérée comme un abandon dès lors qu’elle est injustifiée et persistante. En pratique, beaucoup d’employeurs constatent la situation après 24 ou 48 heures, mais cela ne constitue pas une exigence juridique. A noter que des absences ponctuelles ou étalées sur plusieurs jours peuvent aussi être considérées comme un abandon de poste.
En revanche, l’abandon de poste ne s’applique pas lorsque le salarié quitte son poste de travail sans autorisation de l’employeur pour l’un des motifs suivants :
- Consultation d’un médecin justifiée par son état de santé.
- Décès d’un proche.
- Droit de retrait (ce droit peut être invoqué par un salarié lorsque la situation de travail dans laquelle il se trouve présente selon lui un danger grave et imminent pour sa vie ou pour sa santé).
Que change la nouvelle réglementation ?
Avant la promulgation de la loi Marché du travail, lorsque vous souhaitiez en tant qu’employeur vous séparer d’un salarié qui avait abandonné son poste, vous étiez contraint de procéder soit à un licenciement pour cause réelle et sérieuse (le salarié conservait alors son droit au préavis et son indemnité de licenciement), ou à un licenciement pour faute grave. Cette démission dissimulée permettait ainsi au salarié en question de pouvoir prétendre à une allocation chômage (sous condition en cas de licenciement pour faute grave).
Face à cette dérive, le législateur a introduit dans la loi Marché du travail une présomption de démission en cas d’abandon de poste. Une loi promulguée le 18 avril 2023, et qui n’a cessé d’être remise en cause par les syndicat de salariés, sans succès. Plusieurs décisions de juridictions administratives et judiciaires ont confirmé la légalité du dispositif, jusqu’à même une décision rendue fin décembre 2024 par le Conseil d’Etat, entérinant de facto ce nouveau principe de présomption de démission.
Concrètement, l’employeur a désormais la possibilité de mettre en demeure le salarié, par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge, lui demandant de justifier son absence et de reprendre son poste dans un délai de 15 jours calendaires. A défaut de réponse dans ce délai, le salarié est présumé avoir démissionné, ce qui ne lui permet plus de bénéficier de l’allocation chômage. Dans ce cas de figure, le préavis de démission ne sera ainsi pas exécuté, et l’employeur n’aura donc pas d’indemnité compensatrice à verser au salarié. Dans sa dernière décision en date, le Conseil d’État a bien souligné la nécessité pour l’employeur de bien préciser l’ensemble de ces points dans son courrier remis au salarié présumé démissionnaire. De manière à ce que ce dernier soit informé explicitement des conséquences de son inaction.
A noter que cette procédure n’est pas obligatoire, l’employeur conserve toujours la possibilité de licencier le salarié qui a abandonné son poste pour faute grave.
Lire aussi : Dossier spécial : Optimiser sa rémunération pour un chef d’entreprise
Quel recours possible pour le salarié ?
De son côté, le salarié conserve toujours la possibilité de contester cette présomption de démission, en avançant par exemple des raisons médicales, son droit de grève ou son droit de retrait. Dans le même temps, « le salarié qui conteste la rupture de son contrat de travail sur le fondement de cette présomption peut saisir le conseil de prud’hommes. (…) Il statue au fond dans un délai d’un mois à compter de sa saisine », précise le décret d’application de la loi.
Dans ces cas, si le conseil de prud’hommes confirme que le ou les motifs invoqués par le salarié sont légitimes, ce dernier n’est pas tenu de reprendre son travail tant que l’employeur n’y aura pas remédié.
Une procédure stricte
Dans ce contexte, et même si la jurisprudence du Conseil d’Etat apporte une sécurité juridique aux entreprises, les employeurs doivent plus que jamais adopter une procédure rigoureuse pour éviter tout litige. Et notamment veiller à ce que l’abandon de poste soit volontaire et non lié à un motif légitime. De même, il est primordial de bien vérifier au préalable que les mises en demeure soient claires et conformes au cadre légal. En cas de non-respect, la présomption de démission peut en effet être contestée devant les tribunaux.
Dès lors, pour ce type de procédure, il est vivement recommandé de vous faire accompagner par un professionnel, que ce soit un avocat spécialisé dans le droit du travail, votre cabinet comptable ou vous pouvez également vous rapprocher de votre syndicat professionnel.
Lire aussi : Comment faire face aux arrêts maladies prolongés ou répétés d’un salarié ?
.
Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de toute nouvelle évolution réglementaire et législative qui concernerait les entreprises, aussi n’hésitez pas à vous inscrire à notre newsletter.
Restez informés de l’actu pour les commerçants et indépendants :

Cet article vous a été offert !
Abonnez-vous et soutenez le média qui défend les commerçants indépendants.
Je m’abonne




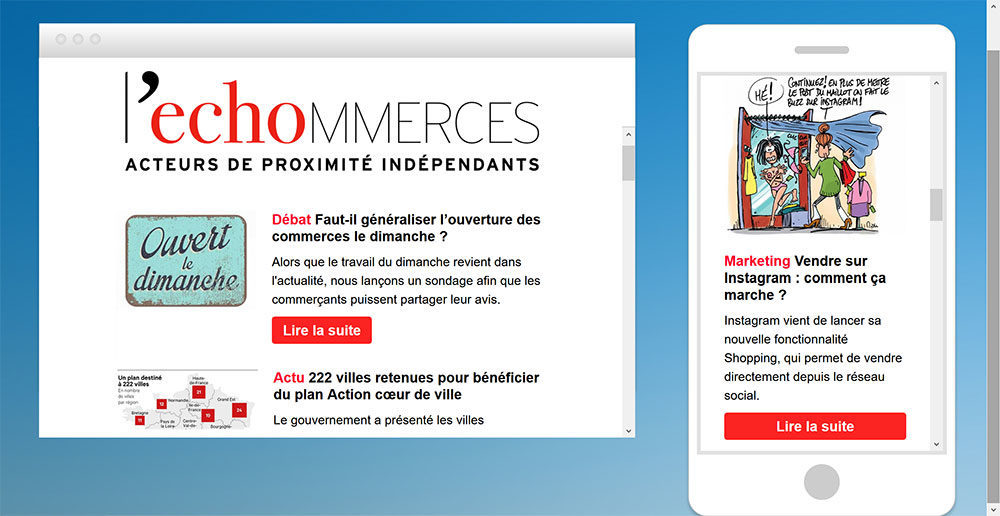
Ce projet est d’une naïveté impressionnante… La plupart des absences sont couvertes par un arrêt de travail établi par un médecin complaisant [il suffit de lui dire : « il y a trop de pression au travail ; je n’en peux plus », pour que ce dernier sorte l’arrêt de travail]). C’est tellement fréquent que certains médecins devraient se faire contrôler par les services de l’Etat et recevoir des amendes voire des mises à pied pour leur comportement… et on va me rétorquer, à juste titre, que ce pays manque déjà d’énormément de médecins pour soigner tout le monde. En conclusion :… Lire la suite »
Dans le cas que vous décrivez il s’agit d’un arrêt maladie donc une absence justifiée, peut être délivrée par un médecin complaisant, mais néanmoins justifiée. Il ne s’agit donc pas d’un abandon de poste au sens de ce contre quoi cette loi cherche à luter.
[…] Lire aussi : Abandon de poste : Tout savoir sur la nouvelle procédure […]
[…] Lire aussi : Abandon de poste : Ce qu’il faut savoir sur la nouvelle réglementation […]
[…] Lire aussi : Abandon de poste : Pourquoi la nouvelle règlementation pourrait pénaliser les employeurs ? […]